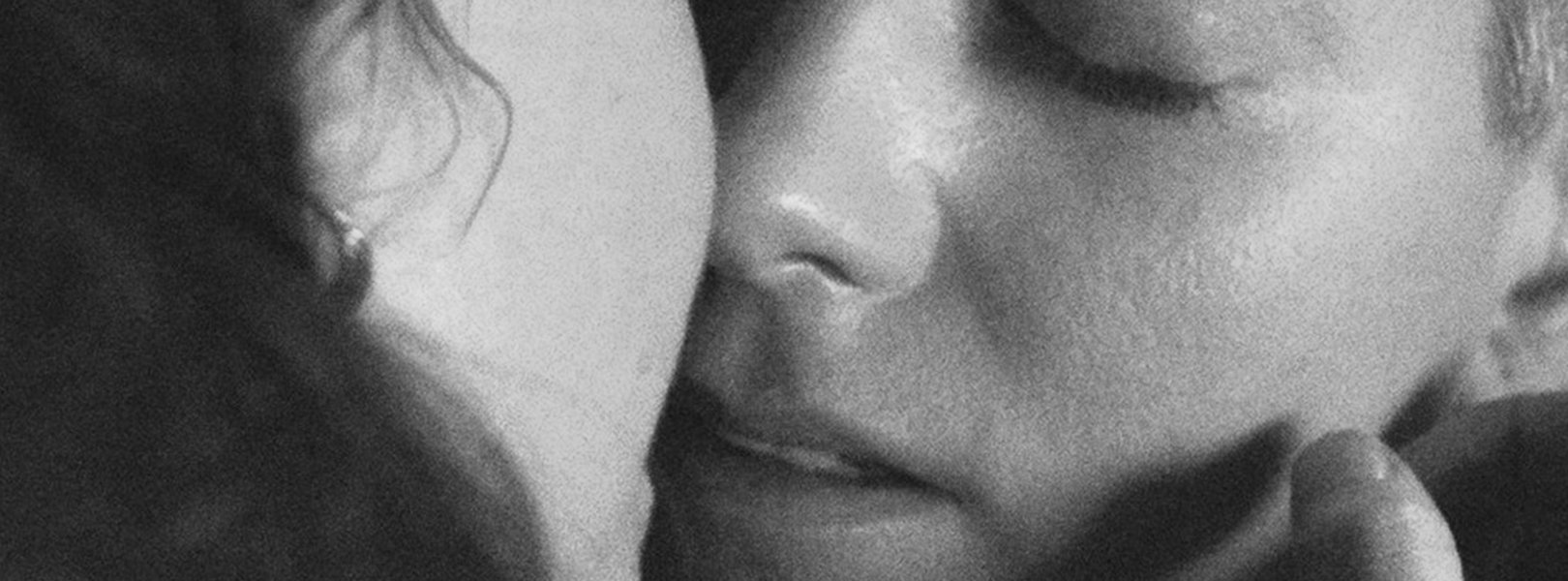☛ This article is also available in English [➦]
La série télévisée Feel Good raconte l’histoire autobiographique et fictionnalisée de Mae Martin (Mae Martin), humoriste et acteur.trice, alors qu’iel entame une relation passionnelle avec George (Charlotte Richie), tout en tentant de naviguer les aléas de son identité de genre et de résister à l’envie de consommer la drogue à laquelle iel est dépendant.e depuis son adolescence. Réalisée par Ally Pankiw, mais co-écrite par Mae Martin et Joe Hampson, la série est parue en mars 2020 sur Netflix, quelques temps après que le premier confinement ait été annoncé. Si Feel Good a probablement été, à ce moment-là, la bouée de sauvetage de plusieurs d’entre nous, j’en propose de nouveau l’écoute pour ceux et celles qui n’auraient pas encore eu droit à ce petit plaisir touchant, désarçonnant et comique.
On rencontre d’abord Mae Martin, né.e dans une famille privilégiée du Canada, mais ayant vécu.e une adolescence difficile, liée à la consommation et à l’itinérance. Iel travaille désormais comme stand-up comique au Royaume-Uni, où iel rencontre George et tombe en amour. Ce début de relation entraîne son lot d’anxiété, d’insécurités et de questionnements, qui se surajoutent tant bien que mal au travail émotionnel lié à ses rencontres hebdomadaires avec son groupe de soutien. Plus la série progresse, plus l’identité de genre devient un arc narratif important. En effet, Mae se sent confronté.e par le désir, surtout hétérosexuel, de sa nouvelle partenaire, et par les attentes genrées qu’iel projete sur son propre corps : « I am so tired, all the time, from trying to be [...] what I imagine her dream version of her high school boyfriend is » (E5, 16:00). Feel Good explore avec habileté et nuances l’impact des relations et de l’orientation sexuelle sur la perception et la performance de son genre.
De son côté, George, professeure au secondaire, expérimente pour la première fois son homosexualité, ce qui soulève de nombreuses peurs et incertitudes vis-à-vis son coming-out et sa découverte des luttes LGBTQIA2S+. À ce sujet, une scène m’a particulièrement marqué. Après être intervenue dans sa classe pour réprimander une insulte homophobe, George rencontre sa directrice pour l’informer abruptement qu’à partir de maintenant, elle enseignera les enjeux LGBTQ+ dans sa classe. Or, la directrice lui rétorque que cela – la santé sexuelle et les droits humains – fait déjà partie de sa charge d’enseignement et que ce serait problématique si elle n’avait pas déjà abordé ces matières en classe. Le subtil renversement met de l’avant un angle-mort dans l’enseignement de George, ainsi que la manière dont sa relation avec Mae conduit à une prise de conscience radicale et intime des enjeux queers.
Sur le plan esthétique, Feel Good se caractérise par un humour et des dialogues parfois absurdes et cringes. La série met en scène une panoplie de personnages aux traits grossis. On y rencontre une amie inexpressive et robotique, une mère très crue, fuyant les émotions, de même qu’une mythomane et un humoriste à la masculinité toxique. Si l’on ajoute à cela les plans très rapides, l’instabilité de la caméra, ainsi que les ruptures de scènes abruptes, on obtient un rythme étourdissant et impulsif qui semble bien représenter l’univers intérieur – anxieux et bouillant – du personnage principal.
S’il m’a fallu au moins deux épisodes pour m’accoutumer au style de la série, Ally Pankiw, Mae Martin et Joe Hampton réussissent à aborder de façon accrocheuse et percutante des thèmes comme la santé mentale, la dépendance aux drogues, l’identité de genre et le coming-out. Une seconde saison est également disponible sur Netflix.
Référence :
Réalisation/création : Ally Pankiw
Titre : Feel Good
Date de parution : 19 mars 2020Cette série est disponible sur Netflix.