Le ministre Roberge affirmait, la semaine dernière, vouloir en finir avec « la confusion linguistique » en interdisant l’usage de l’écriture inclusive dans toutes les sociétés d’État. Cette annonce, loin d’être isolée, s’inscrit dans un mouvement plus large de repli identitaire et de politiques aux tendances conservatrices qui cherchent à réaffirmer des traditions perçues comme immuables. En effet, au Canada comme ailleurs, ces débats s’arriment à une recrudescence de discours remettant en question diverses avancées sociales touchant les droits des personnes LGBTQ+, les modèles familiaux pluriels ou encore l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI).
Au Québec, cette interdiction s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par une préoccupation réelle autour de la vitalité du français. Protéger notre langue commune est un objectif légitime, tant elle est un vecteur d’identité et un outil de cohésion sociale. Or, la défense du français ne devrait pas être présentée comme incompatible avec l’inclusion. Au contraire, l’écriture inclusive, loin de fragiliser la langue, permet de l’enrichir et de mieux refléter la pluralité des personnes qui la parlent et la vivent.
Rappelons que la langue n’est jamais neutre : elle façonne notre manière de voir et de nommer le monde. Utiliser des termes qui reconnaissent la diversité des réalités humaines est une façon concrète de lutter contre les discriminations. À l’inverse, imposer des règles restrictives peut contribuer à normaliser un climat d’exclusion et d’ostracisation.
De plus, la décision du ministre Roberge amalgame l’ensemble des méthodes d'écriture inclusive, en ne distinguant pas ses divers usages. En effet, le recours à des formes neutres ou non binaires (iel, points médians, double flexion) peut être utilisé soit pour désigner un ensemble d’individus ou pour désigner spécifiquement les personnes trans et non binaires. En refusant cette distinction, on nie symboliquement l’existence de ces personnes et on fragilise leur reconnaissance sociale et politique.
Ces décisions ministérielles ne sont pas que symboliques. Elles s’inscrivent dans un climat social où la haine – et particulièrement envers les femmes et les personnes trans et non binaires – prend de l’ampleur tant en ligne que hors ligne. Dans ce contexte, la question de la langue ne devrait pas être instrumentalisée pour opposer la protection de la langue française et la reconnaissance des diversités. Il est possible – et nécessaire – de conjuguer les deux. Défendre la vitalité du français ne doit pas se faire au détriment des femmes et des personnes trans et non binaires.
La langue française est riche, vivante et capable d’évoluer. Elle peut à la fois porter l’histoire et les luttes du Québec, et refléter les réalités contemporaines de celles et ceux qui y vivent. Plutôt que de dresser un faux dilemme entre protection linguistique et inclusion, choisissons de voir dans l’écriture inclusive une occasion de faire rayonner le français en en faisant une langue qui accueille, qui nomme et qui reconnaît l’ensemble des voix qui la font vivre.
Vous pouvez vous procurer notre guide d'écriture inclusive ou réserver la formation sur l'écriture inclusive.
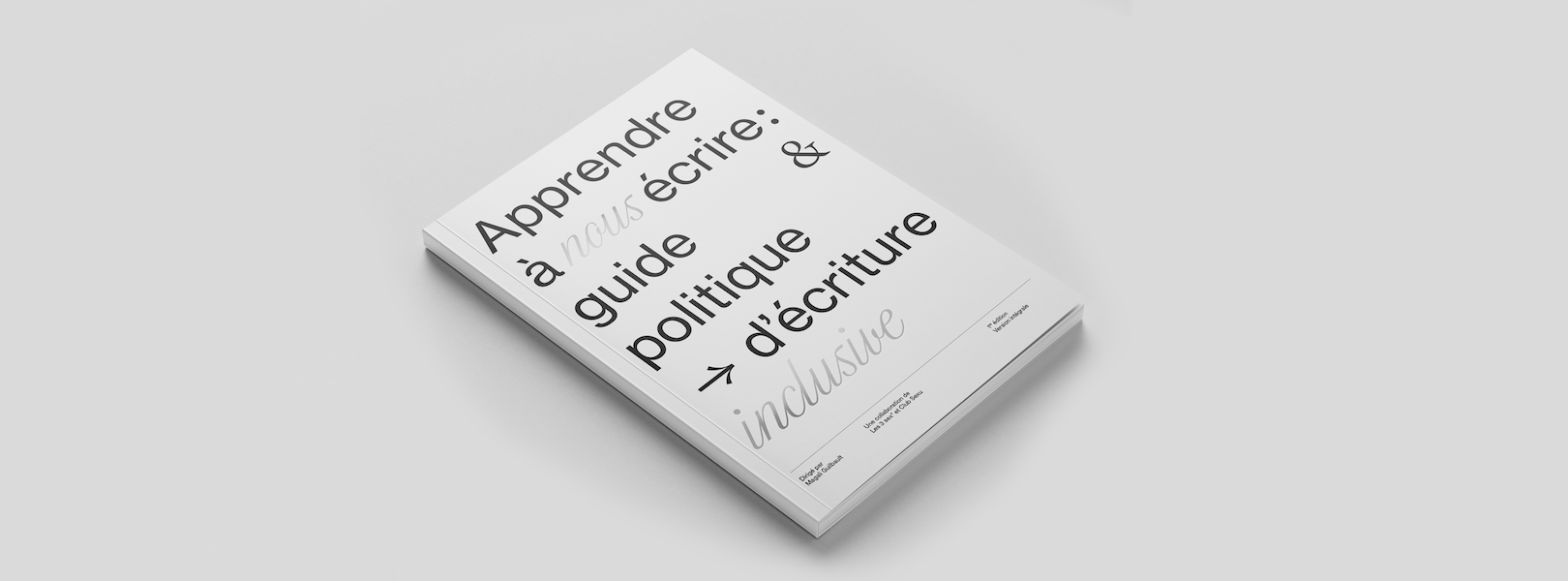
Commentaires